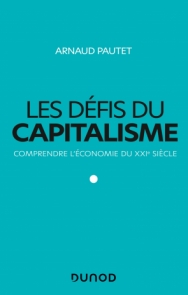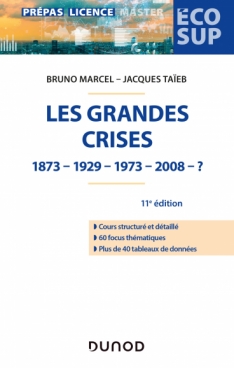Face aux passions contraires que le capitalisme nourrit, Les défis du capitalisme revient sur son histoire longue afin de « dédramatiser » le problème économique et interroger le rôle qu’il pourrait jouer dans la recréation d’un destin solidaire et commun
Pour mieux comprendre le monde économique dans lequel nous vivons et interroger nos pratiques économiques en période de crises, Arnaud Pautet, avec la collaboration de Francis Plancoulaine, revisitent dans un style facile et agréable à lire les grandes questions et débats de la science économique sur une histoire longue. Rencontre avec les auteurs :
Arnaud Pautet, il y avait-il urgence en cette période de crise pandémique, économique et écologique planétaire à écrire cet essai ?
Le projet d’écrire cet essai sur le capitalisme était venu en 2019, à l’occasion d’un cycle de conférences sur ce thème donné au Collège supérieur, un institut de formation supérieur lyonnais. Mais la conjonction, l’ampleur et la durée du mouvement des gilets jaunes, des manifestations contre la réforme des retraites, puis la pandémie, m’ont incité à transformer ces premières réflexions en un ouvrage plus abouti autour des grands défis du capitalisme contemporain. Nous semblions condamnés à affronter sans cesse des « cygnes noirs », ces événements imprévisibles mettant à l’épreuve nos sociétés, les amenant à cultiver la résilience et à s’adapter. Comme l’explique Nassim N. Taleb, il nous fallait apprendre à devenir « anti-fragiles » face à des crises souvent imprévisibles, démultipliées par la globalisation du numérique, de la finance, et l’accélération du rythme de l’innovation.
Le sujet apparaissait comme un puits sans fond et il fallait définir un périmètre pour cadrer la réflexion. J’ai donc retenu six thèmes principaux : les mutations historiques du système capitaliste, si bien esquissées par Fernand Braudel ou François Perroux, et la coexistence à chaque époque de plusieurs formes de capitalisme ; les liens complexes entre croissance et prospérité, abondance et bien-être ; l’impact de la mondialisation sur la nature et l’intensité des inégalités ; la question de la détention du pouvoir dans l’entreprise, objet d’une compétition acharnée entre l’entrepreneur, le manager et l’actionnaire, souvent au détriment des travailleurs ; les transformations du monde du travail, et la prétendue remise en question du salariat par l’ubérisation ; et la place de la finance dans le monde contemporain, lubrifiant indispensable de l’économie, mais qui tend à devenir toxique à mesure que ces acteurs financiers sont frappés d’obésité.
Comprendre comment le capitalisme se réinvente en surmontant les crises qu’il engendre
L’idée fondatrice de l’essai est de comprendre, et de déconstruire, les discours anxiogènes qui dominent lorsqu’on évoque, dans les médias notamment, le capitalisme, pour insister sur la capacité du système à se réinventer en surmontant les crises qu’il engendre. La dynamique du système reste le fruit de l’interaction des acteurs, des rapports de force et des capacités de négociation entre eux.
L’urgence à écrire cet essai était donc celle de la nécessité de restituer les trames historiques permettant de comprendre les mutations actuelles qui souvent inquiètent et parfois émerveillent. Depuis la révolution industrielle, qui commence en Angleterre à la fin du XVIIIème siècle, les sociétés humaines connaissent des transformations économiques sans précédent et qui s’accélèrent au point que chaque être humain sur la planète est susceptible de vivre dans un monde complètement différent entre le moment de sa naissance et celui de sa disparition. Qu’elles soient anxiogènes ou stimulantes, les directions impulsées par ces mutations n’ont rien de définitif : elles dépendent des choix individuels et collectifs qui rendent le meilleur et pire possibles en même temps.
Avant même la crise de la Covid 19, vous rappelez que nous étions déjà entrés dans une période de transition économique, inaugurant une nouvelle ère du capitalisme pour relever les défis du XXIe siècle. Grâce à sa « plasticité », le capitalisme a donc su, une fois encore, changer ses propres règles pour survivre ?
En fait, plus que d’une transition, je parlerais volontiers d’un éternel recommencement, l’histoire du capitalisme décrivant une oscillation permanente entre le marché et l’État, ainsi que le remarque Paul de Grauwe.
Comme l’a brillamment montré Karl Polanyi, le capitalisme profite des phases de croissance et de paix pour se désencastrer, s’extraire et s’autonomiser de la société. Il réduit l’emprise du politique sur l’économie en quelque sorte, pour investir de nouveaux marchés, transformer en propriété privée des biens initialement non-marchands, comme la terre, et s’étendre à l’échelle mondiale, parfois par la violence, en colonisant des territoires lointains riches en hommes et en ressources. Karl Marx ajoute qu’il privatise progressivement le travail au cœur de la production, par l’entremise du salariat, car le capitaliste sait que le capital n’est que du « travail sédimenté », et que son profit dépend du travail de ceux qui ne possèdent pas les moyens de production.
Le salariat réduit dans un premier temps le travailleur à une marchandise caractérisée par un prix, récompensant son utilité marginale. Mais les luttes collectives adossent à ce système d’exploitation des protections, nos « acquis sociaux ».
Dans un second temps, au XXème siècle, le salariat se répand dans la société : à mesure que la rente terrienne s’effondre, minée notamment par l’inflation de la Première Guerre mondiale, de nouveaux venus sont obligés de travailler pour gagner leur vie. Ces « nouvelles couches » de la fin du XIXe siècle, ainsi désignées par Gambetta, sont les futures classes moyennes auxquelles le capitalisme promet un paradis terrestre, pour eux et leurs enfants. Leur adhésion au capitalisme tient à cette promesse et repose sur la croyance en un capitalisme méritocratique. C’est cette croyance qui est ébranlée en Occident depuis le milieu des années 1970, et qui fait vaciller le système.
Lors des crises, les capitalistes, démunis, acceptent cependant une reprise en main par l’État, un réencastrement. Ce fut le cas entre les deux guerres mondiales avec, à la faveur notamment de la crise de 1929, la naissance des États-providence. Polanyi parle de « grande transformation ». L’histoire semble parfois bégayer. Après un nouveau désencastrement dans les années 1980, accéléré par la dissolution du bloc communiste en 1991, nous vivons depuis la crise de 2008 une période paradoxale : la grande transformation semble, par certains côtés, enclenchée, comme le montre le rôle croissant des banques centrales dans la régulation du système financier international et l’orchestration des plans de relance de l’économie mondiale confinée par des États pompiers volontaristes et conscients de l’urgence écologique.
Les plus libéraux des économistes en appellent à l’État pour sauver le système, allant jusqu’à défendre la dette publique qu’ils fustigeaient six mois plus tôt. Mais d’un autre côté, chaque crise est l’occasion, notamment en Europe, d’une réaffirmation de la nécessité d’une réforme fondamentale des services publics jugés trop peu efficients. Les mêmes économistes plaident pour l’accélération de la privatisation du patrimoine public, la réduction des effectifs de la fonction publique, le retrait de l’État d’une partie de la prévoyance au profit d’institutions privées (pas toujours plus efficaces, si l’on considère la médiocre gestion des fonds de pension chiliens créés au temps des Chicago Boys de Pinochet)… Et surtout la réduction des impôts sur le capital et ses revenus ainsi que celle des cotisations sociales, afin d’attirer des entreprises qui, sinon, joueront de l’optimisation fiscale. Une menace souvent entendue par les pouvoirs publics, même si le prix à payer est un affaiblissement notable des États, privés de ressources à court terme et contraints de s’endetter auprès de ces mêmes acteurs financiers.
La « grande transformation » que les générations montantes appellent de leurs vœux
Pour l’instant, les nouvelles règles ne sont donc pas encore posées. Et pourtant, il est assez simple de tracer un sillon dans lequel planter les graines d’un capitalisme désirable : la « grande transformation » que les générations montantes appellent de leurs vœux nous guide vers une certaine sobriété écologique, une société où l’accès (à des services) prime la possession (de biens d’usine). Cette révolution n’adviendra pas sans une politique pro-active de l’État, qui doit inventer des stratagèmes (les économistes diront des incitations) pour réorienter la gigantesque épargne enfouie dans les activités carbonées, vers des activités plus soutenables. Sans quoi la « bulle carbone » décrite par Jeremy Rifkin risque d’exploser et de mettre à mal des pans entiers de la vieille économie. Une réforme financière et fiscale d’ampleur est la condition du changement, pour accompagner la mutation amorcée du comportement des entreprises (plus de responsabilité sociétale et environnementale) et des consommateurs (goût pour les circuits cours, essor d’un marché de l’occasion par les plateformes, etc.).
L’électrochoc de la pandémie actuelle a suscité le rêve d’une société « démondialisée » et « réhumanisée ». Le procès de la mondialisation sera-t-il inéluctable ?
La mondialisation a d’abord été rapidement disculpée, quand l’épidémie est devenue pandémie. Cette dernière était la résultante d’un choc exogène, à savoir la contamination probable d’un animal acheté sur un marché chinois aux règles d’hygiène incertaines. La finance n’était pas responsable (contrairement à la crise des subprimes), ni d’ailleurs les firmes internationales se livrant bataille sur le marché mondial. Pourtant, à y regarder de plus près, la pandémie puise sa source dans les excès de nos sociétés interconnectées, interdépendantes, qui se sont coupées de la nature en adhérant sans réserve à un discours techno-optimiste et en donnant la priorité absolue au cost killing, au risque de sacrifier la raison d’être des entreprises, c’est-à-dire le désir de participer à une aventure collective, le goût de la coopération.
Aussi, la pandémie est bien le fruit de la croissance urbaine et industrielle débridée de la Chine, où les villes tentaculaires grignotent les forêts à une allure inédite dans l’histoire. Cette démesure a pour conséquence de chasser la faune de son habitat naturel ; elle crée l’occasion de contagions croisées entre les animaux sauvages et domestiques, puis entre les animaux domestiques et l’homme, comme cela avait déjà été le cas pour la fièvre Nipah en Malaisie à la fin des années 1990.
Surtout, la pandémie révèle les fragilités nées de l’interdépendance mondiale. La lutte pour l’optimisation des coûts et l’élimination des stocks, la confiance aveugle dans l’infaillibilité de notre supplying chain, portée par les progrès de l’informatique et du transport maritime, nous ont amenés à externaliser 80% de nos principes actifs de médicaments en Inde et en Chine, ainsi que la production de masques chirurgicaux ou encore de papier hygiénique. Qu’un seul grain de sable se glisse dans ces rouages parfaitement huilés, et la cinétique mondiale cesse. Nous l’avons vu encore ces derniers jours avec cet immense porte-conteneur de la société Evergreen qui, bloquant le canal de Suez, a fait ressurgir la peur de la pénurie en stoppant net le fret maritime mondial.
Tous les joueurs dans le Monopoly mondial considéraient qu’il s’agissait d’un jeu à somme positive
La mondialisation n’a pas tenu parfaitement ses promesses de convergence, même si elle a fait reculer la pauvreté dans la plupart des pays à revenus intermédiaires. Elle a creusé des inégalités internes abyssales brillamment décrites par Branko Milanovic. Plutôt que de croire à la fable d’une démondialisation générale, nous devons faire l’inventaire des activités qu’il est pertinent de délocaliser, et celles qui, stratégiques, ne doivent pas quitter notre sol. Avant même cette crise sanitaire, beaucoup d’experts avouaient à mi-mot que le choix de s’être dépossédés de l’outil de production, pour se convertir à une société « postindustrielle », avait été une erreur pour les vieilles économies industrielles. Nous avons pêché par naïveté en croyant que tous les joueurs dans le Monopoly mondial considéraient qu’il s’agissait d’un jeu à somme positive. Or les pays émergents se considèrent comme des puissances mercantiles, la Chine en premier lieu, qui voit le négoce international comme un jeu à somme nulle : elle gagne ce que les autres perdent. Les transferts technologiques, le dépouillement de nos systèmes productifs, ne peut se faire sans garanties et sans contreparties.
Comme vous le dites, il faut en effet « ré-humaniser » notre économie, en fondant la croissance future sur des services producteurs de bien-être et d’épanouissement, comme nous y invite Pierre Veltz dans son dernier ouvrage, L’économie désirable (2021). Parmi eux, le secteur du care, de la santé, de l’éducation, de la formation, est une priorité. Le prix des biens manufacturés décline rapidement, grâce à la concurrence mondiale. Leur part dans le budget des ménages diminue, ce qui libère du pouvoir d’achat pour des services de qualité. Faisons en sorte qu’ils se transforment en un trésor d’emplois non délocalisables, soutenables écologiquement et socialement, et suffisamment rémunérés pour que leurs détenteurs puissent s’offrir une vie décente ainsi qu’à leurs enfants.
En attendant ces transformations salvatrices, l’OMC annonce que le commerce international a été moins pénalisé par la crise de la Covid que par la crise financière de 2008. Les échanges internationaux de biens et services ont en effet reculé de -5,3% en 2020 contre -12% en 2009. Selon l’OMC, « La contraction du commerce mondial a été 1,6 fois supérieure à la chute du PIB en 2020 contre 7 fois pendant la crise de 2009 ». Les confinements donc semblent avoir moins perturbé les chaînes de valeur que la pénurie de crédits en 2009. Le commerce des biens a bénéficié du recul de la consommation de loisir, notamment celle liée au tourisme. Enfin, l’OMC prévoit un rebond spectaculaire du commerce mondial dès 2021, comme si le retour des affaires « as usual » était l’horizon de court terme le plus probable.
Nous sommes aujourd’hui dîtes-vous « à la croisée des chemins et il nous faut choisir entre deux formes de capitalisme ». Quels sont-ils et quel visage le capitalisme, convalescent de la Covid 19, pourra-il prendre dans les prochaines décennies ?
Comme souvent, nous semblons à un carrefour des choix de société, pour reprendre une image utilisée par les altermondialistes au seuil de ce siècle. Plusieurs capitalismes s’affrontent : Branko Milanovic oppose un capitalisme libéral-méritocratique (américain) et un capitalisme politique autoritaire (chinois). Pierre-Noël Giraud distingue trois capitalismes : un capitalisme « en îlots ruisselants », misant sur quelques activités phares, ciblées sur la frontière technologique (numérique, biotechnologies, data, etc., comme Singapour) et attirant des emplois nomades (soumis à la concurrence internationale) pour créer de la richesse et faire vivre un arrière-pays où l’emploi est principalement « sédentaire » (à l’instar des pays européens) ; un capitalisme « compact », cherchant à dominer tous les secteurs innovants (des pays à forte population et gigantesques, comme la Chine) ; et un modèle hybride, imitant Singapour, propre aux petits pays très ouverts sur le monde extérieur (comme les États pétroliers du Golfe).
On doit rêver à un capitalisme plus solidaire
Je distinguerai pour ma part deux futurs possibles, l’un nous enfermant dans un capitalisme émotionnel déjà triomphant, l’autre nous orientant vers un capitalisme solidaire et libérateur. Indéniablement, nous construisons un capitalisme de la peur : notre monde nous inquiète car il est devenu multipolaire, avec des puissances émergentes ambitieuses et agressives, sans qu’on soit jusqu’alors parvenus à écrire des règles multilatérales claires et acceptables par tous les pays. De fait, le risque est omniprésent et par nature les agents économiques ont peur du risque, essaient de s’en protéger. Les secteurs couvrant ces aléas (assureurs, investisseurs institutionnels, etc.) ont donc de beaux jours devant eux. Par ailleurs, le long terme effraie dans notre « société liquide » où la nouveauté d’un jour est passée de mode le lendemain. Cette fragilité inhérente à un monde sans racine empêche les individus, constamment en mouvement, de prendre du recul. Ils sont enfermés dans l’instantanéité, le règne de l’émotion et le désir infini et insatiable. Les entreprises ont bien compris qu’un immense marché s’offrait à elles: plateformes et réseaux sociaux convoquent d’ailleurs les services de psychologues pour mieux cerner la psyché de leurs consommateurs, qui leur livrent imprudemment et gratuitement une quantité infinie d’informations sur leur état d’esprit, leurs préférences, leurs désirs, leur consommation. Face à ce monde orwélien, dominé par des industries du numérique surpuissantes qui tissent sur la toile une sorte de « techno-féodalisme », comme le dit Cédric Durand, on doit rêver à un capitalisme plus solidaire : beaucoup d’entreprises questionnent la coopération, le commun, évidemment souvent à partir des questions écologiques qui les amènent à bouleverser leur process pour s’adapter à des clients dont les aspirations changent : on pensera à H & M qui récemment a refusé d’acheter du coton chinois dans le Xinjiang car la marque (et ses consommateurs) s’indignai(en)t du sort réservé aux Ouïghours dans l’empire du Milieu. Ce capitalisme solidaire rejette la consommation de masse, plébiscite les circuits courts et le recyclage, attend de l’État qu’il soit une force d’impulsion d’une bifurcation sociale-écologique pour transformer en premier lieu notre habitat urbain et nos transports.
Les élèves des classes prépas et les étudiants à l’université notamment auront quels bénéfices à lire votre essai par rapport à un manuel plus traditionnel ?
Cet essai a été construit en partie grâce à mes propres étudiants de classe préparatoire : par leurs questions, leurs incompréhensions, ils m’invitent à chercher les bonnes références, les exemples faisant lien entre la carte et le territoire, la théorie et les faits observables à l’échelle des entreprises. J’ai eu à cœur de construire l’ouvrage autour de ce dialogue entre des grands auteurs, ces géants sur les épaules desquels nous sommes juchés, et des illustrations venues d’entreprises confrontées aux changements décrits. Je remercie d’ailleurs les éditions Dunod d’avoir fait les efforts nécessaires pour que l’on puisse éditer de larges extraits significatifs de la pensée des auteurs.
Aider le lecteur à affiner sa propre vision
Ma formation initiale d’historien me donne incontestablement un regard différent de mes collègues de sciences sociales : j’ai cherché constamment à réinsérer les problèmes abordés dans le temps long de l’histoire, qu’il s’agisse du capitalisme, des inégalités, de la finance, du salariat. La souplesse de l’essai, enfin, me permet de bâtir des ponts entre ces différentes questions, dans l’introduction et la conclusion… un luxe que les manuels peuvent rarement s’autoriser. Il s’agissait moins de donner un prêt à penser que de proposer des références, parfois contradictoires, pour aider le lecteur à affiner sa propre vision.
Des questions au cœur des sujets de concours
Affranchi de toute contrainte, j’ai pu insister sur des éléments qui, souvent, sont à la périphérie des programmes officiels mais aussi au cœur des sujets de concours : l’ubérisation du travail, les formes successives du capitalisme, les apports de l’économie comportementale, la pauvreté, l’abondance, les plateformes numériques, etc. Enfin, libéré du carcan du nombre de signes imposés dans la rédaction des manuels, j’ai pu référencer davantage d’auteurs récents, les faire dialoguer, montrer aux lecteurs les passerelles que l’on peut construire entre leurs pensées. Là encore, mon intention était d’éviter tout manichéisme : on peut dénoncer une finance dérégulée et inconséquente avec Thomas Piketty et Gaël Giraud, tout en soulignant les vertus des acteurs financiers avec Augustin Landier et David Thesmar. La polarisation des débats économiques aux extrêmes empêche trop souvent la possibilité d’un débat politique, la recherche d’un compromis fondateur. Modestement, j’espère que ces quelques pages peuvent aider le lecteur à trouver ce plus petit dénominateur commun.
Les Auteurs
Arnaud Pautet
Agrégé et docteur en histoire contemporaine, est professeur en classes préparatoires commerciales au lycée Sainte-Marie de Lyon où il enseigne l’histoire, l’économie et la géopolitique.
Avec la collaboration de Francis Plancoulaine,
Professeur agrégé de sciences sociales enseignant l’économie, la sociologie et l’histoire en classes préparatoires commerciales.
Préface d’Éric Berr,
maître de conférences en économie à l’université de Bordeaux.